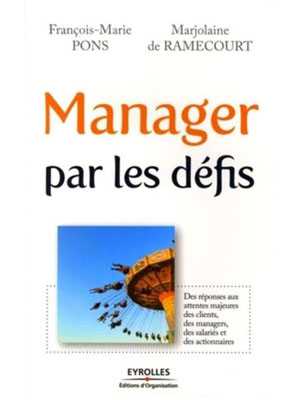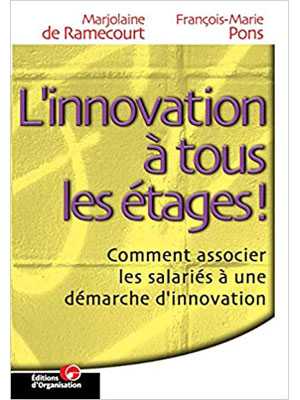Essais
Essais philosophiques
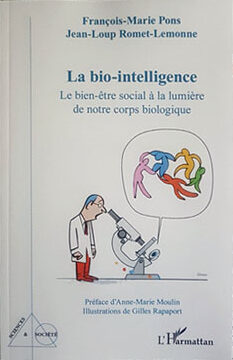
François-Marie Pons et Jean-Loup Romet-Lemonne
La Bio-intelligence
Le bien-être social à la lumière de notre corps biologique
François-Marie Pons, Jean-Loup Romet-Lemonne
Préface Anne Marie Moulin
Dessins Gilles Rapaport
Quoi de plus réjouissant que les cellules de notre organisme nous éclairent sur comment mieux vivre et mieux être en société ? Les clés du bien-être social seraient en chacun de nous. L’étonnement est la matière première de cet essai écrit par deux amis que l’aventure humaine passionne : Jean-Loup Romet-Lemonne, médecin, chercheur en biologie et François-Marie Pons, journaliste, consultant conseil en relations humaines. Tous deux animés par la même conviction que nous disposons des ressources vitales nécessaires à notre épanouissement, refusant d’accepter le mal-être comme une fatalité originelle, inhérente à l’humanité. Ils suggèrent quelles attitudes et quels comportements sont indispensables au bon fonctionnement d’une société humaine et au bien-être social, à la lumière des processus vitaux du corps humain. Et s’étonnent : pourquoi ne pas innover en matière de bien-être social comme pour la santé de notre propre corps ? Anne-Marie Moulin écrit dans la préface « L’essai convainc son lecteur de la capacité des phénomènes biologiques à nous guider sur la voie de résolution des dilemmes contemporains. Réversibilité, diversité, ouverture, une voie sur laquelle les deux auteurs nous entraînent résolument en nous souhaitant bonne route… »
Les auteurs
Jean-Loup Romet-Lemonne, médecin et entrepreneur dans le domaine des biotechnologies, et François-Marie Pons, journaliste et consultant dans celui des relations humaines sont tous deux des chercheurs. Ils ont conjugué leurs expertises, ainsi que leurs convictions humanistes, en vue d’ouvrir les possibles dans le champ du vivant et de la qualité de vie.
 Photo Jecca
Photo Jecca
Jean-Loup Romet-Lemonne
Médecin, chercheur.
Médecin, chercheur, entrepreneur (Faculté de Médecine de Tours, HEC-Management et à Stanford en Californie, Harvard School of Public Health à Boston), Jean-Loup Romet-Lemonne fonde et dirige la biotech IDM Pharma, puis BioBusiness.TV et Traverse Biotech Inc.. Auteur d’une cinquantaine de publications de niveau international, il collabore à un groupement de sociétés savantes en immunologie.
Ancien conseiller stratégique au développement international de l’Institut Pasteur, il participe au développement de biotechnologies françaises.
Il vit et travaille à New York.
 Photo Solène Monnier
Photo Solène Monnier
François-Marie Pons
Journaliste, consultant.
Journaliste, photographe, conseil en créativité et innovation, cofondateur d’une association professionnelle, « Innov’Acteurs », enseignant (Celsa, Paris 13, Edhec, Novancia…), il se consacre à la recherche, à la formalisation pédagogique des concepts, des idées et des modalités d’application, dans le domaine des relations humaines. Conférencier et auteur, il a publié des nouvelles et des scénarios de bandes dessinées pour la jeunesse, des ouvrages méthodologiques, des biographies, des récits, deux romans et de nombreux articles. Formation littéraire, linguistique, psychosociologique.
Il vit et travaille à Paris.

Gabs – François-Marie Pons
Un nouveau Contrat Social pour le XXIème siècle
Alain et Gabillet, dit GABS*, auteur dessinateur et ami, et moi-même avons participé à un concours organisé par l’Institut Jean-Jacques Rousseau de Genève au printemps dernier : proposer un « Nouveau Contrat Social pour le 21ème Siècle »
Vous trouverez le projet complet texte et dessins :
UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
« Relation-nous » les uns les autres
En résumé : La relation est une urgence contemporaine.
La relation n’est pas innée, elle s’apprend. Rousseau souhaitait faire évoluer la société : c’est possible avec des relations humaines de qualité. Bien comprise, bien apprise, bien accomplie, la relation agit comme une étrave capable d’embarquer une société dans son sillage, une société acceptable par et pour toutes et tous, une société vivace qui se tisse tous les jours.
Nous avons proposé un nouveau Contrat Social centré sur la relation humaine. Nous avons été présélectionnés mais pas finalistes !
* Gabs, auteur dessinateur. Site : gabs.fr
Les chapitres développés
- L’enfant ne nous appartient pas, les géniteurs donnent la vie, les parents créent la relation.
- On ne naît pas communiquant, la relation comme discipline pédagogique, dès la maternelle…
- La créativité, c’est aussi écouter les idées des autres, dès qu’il n’y a qu’une seule solution, il n’y a plus de relations.
- Toilettes et bancs publics, la ville est un espace hospitalier.
- S’autoriser tout, ne nuire à personne : le défi de la relation, L’expression en liberté conditionnelle ?
- Consommer pour vivre et non pas vivre pour consommer, une société de surconsommation peut-elle être une société de relation ?
- Une mort en relation avec la vie, un contrat santé-relation : physique, psychologique, mental.
- Les ressources humaines l’ont compris avant l’heure, la relation impacte l’efficacité (mais pas uniquement dans un but de profit).
- La relation est le premier geste écologique, les hommes ont longtemps craint la nature. Aujourd’hui, c’est la nature qui a peur.
- S’exiler est une micro-fin du monde, inventer « ici » une société multirelationnelle avec « là-bas »
Note d'intention
LA RELATION
UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL
Renouer notre lien à la nature, redonner aux démocraties leur vigueur, imaginer les conditions d’un faire ensemble émancipateur : le défi d’un nouveau Contrat Social pour le 21ème siècle est lancé…
La relation humaine : une urgence contemporaine
Bien comprise, bien apprise, bien accomplie, la relation agit comme une étrave capable d’embarquer une société dans son sillage, une société acceptable par et pour toutes et tous, une société vivace qui se construit tous les jours. Nous proposons un nouveau Contrat Social centré sur la relation humaine. Renouer le lien, avec chacun. La relation est une urgence contemporaine.
Une forme brève, imagée, évolutive
Le nouveau Contrat Social doit être en phase avec le monde d’aujourd’hui. Communication, images, interactions, créativité, complexité… en évolution rapide permanente. Nous suggérons une idée forte, une « idée étrave ». La relation est l’idée étrave d’un nouveau Contrat Social. D’où une présentation brève, imagée, évolutive, simple et ambitieuse.
Libérer l’individu par l’éducation
La relation entre les personnes n’est pas naturelle, elle s’apprend.
« La Relation, un nouveau Contrat Social » prolonge des pistes ouvertes par Jean Jacques Rousseau, comme : passer de l’état de nature à l’état de société, prendre les hommes tels qu’ils sont… ou miser sur la libération de l’individu par l’éducation.
Mais, les grandes avancées depuis Rousseau : laïcité, savoirs vulgarisés, nouvelles technologies, mouvements d’émancipation (féminisme, sexualités, écologie…) ne suffisent pas à enrayer les violences, les injustices, les conflits, les maltraitances. Si on ne comprend pas, si on ne se comprend pas, ça conduit à la guerre.
L’éducation relationnelle : une matière comme les autres.
Il n’est pas question d’injonction morale ou de bon sens. La relation acceptable et fructueuse est une pratique qui nécessite un apprentissage. L’objectif est d’inciter vivement les gens à se former, leur donner le goût d’apprendre à s’entendre entre eux. Le nouveau Contrat Social stipule que la relation humaine devienne une matière éducative principale, comme tout autre matière essentielle de l’enseignement.
La relation commence là où l’autre comprend
Traditionnellement, il est admis que ce nous communiquons c’est ce que nous disons. La réalité nous enseigne le contraire : ce que nous communiquons, c’est ce que l’autre a compris.
S’intéresser à ce que l’autre a vraiment compris, prendre le temps de la relation est un nouveau langage adapté, acceptable, au contraire d’expressions impulsives et souvent dévastatrices. Un nouveau contrat contribue à une relation apaisée.
Le rôle de la politique : bien-être social
La politique consiste avant tout à créer un contexte favorable à des relations respectueuses et au bien-être social des citoyens, pour que chacun trouve sa place démocratiquement, sans promesse d’un bonheur collectif illusoire.
Les situations relationnelles sont les véritables leviers d’un vivre ensemble.
Pour commencer à s’y mettre
« Le commencement est la moitié du tout » (Pythagore) Nous proposons des articles qui nous paraissent indispensable pour commencer : Ils sont appelés à évoluer en fonction des expériences. Certains proposent des idées nouvelles, d’autres de généraliser des expériences ponctuelles qui marchent bien ici et là.
Chaque article est illustré et suggère une proposition concrète à partir d’un principe qui impacte la relation.
UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL : « Relation-nous » les uns les autres
« Tirer avec » (con trahere), c’est le sens initial du mot contrat : on tire ensemble. Les principes et expériences de vie telles qu’évoquées dans le nouveau Contrat Social se répandent, sont de plus en plus reconnues et durables. Elles font leur preuve et montrent que c’est possible, c’est à la portée de chacun de faire d’une relation équitable et respectueuse une « étrave » puissante pour construire une société viable, acceptable, intelligente.
Le but du nouveau Contrat Social vise à généraliser ces expériences auprès du plus grand nombre, à les transmettre, les adapter, les faire évoluer sans perdre le fil de la relation qui détermine le sens d’une société à vivre.
La relation réconciliée
François-Marie Pons
Un défi humanitaire créatif
« Que deviendra l’homme sans Dieu et sans immortalité ?
Tout est permis par conséquent, tout est licite ? »
Dostoïevski
« Les Frères Karamazov »
Handicaps relationnels et créativité.
L’écriture de cet ouvrage a été déclenchée par une question : pourquoi y-a-t-il autant d’« handicapés relationnels » dans la société ? Tant de parents et d’éducateurs déconcertés face aux enfants, de managers maladroits face aux collaborateurs, d’experts arrogants face aux utilisateurs, d’élus déconnectés face aux citoyens ?
Et elle a été inspirée par une croyance : cette situation n’est pas inéluctable, elle est culturelle, elle est transformable, à condition de réveiller en chacun de nous deux ressources originelles de l’homme : la créativité et la sagesse, évincées l’une et l’autre par les excès du rationalisme et de la rhétorique, mais également par l’attrait du pouvoir et du besoin d’absolu.
Face à cette question et au nom de cette croyance, une priorité s’impose : il est grand temps de considérer la relation humaine comme un facteur décisif de civilisation, comme un travail à part entière qui s’apprend et s’organise, comme une discipline philosophique qui s’expérimente au quotidien.
Le sujet même de la relation humaine est traditionnellement traité sous un angle spirituel ou moral, formalisé à travers des discours didactiques, incarné dans des créations littéraires et artistiques. Les récentes démarches de psychologie appliquée et de communication[1] apportent des réponses novatrices et concrètes au fonctionnement des attitudes et des comportements. Même si ces approches cèdent parfois à des schématisations réductrices, elles contribuent à reconnaître la relation humaine comme un champ d’expertise où il est possible de progresser.
L’essentiel de La relation réconciliée vise à montrer que la relation humaine est une initiative créative et prospère, qu’elle constitue une grande promesse du troisième millénaire devenue possible grâce à la conquête de l’homme sur son inconscient, sur sa propre nature au-delà de la Nature, sur son aptitude éprouvée et réitérable de la bienveillance.
La tâche est conséquente (les actes barbares perdurent bel et bien, on en connaît les causes et les effets), elle fera basculer l’ordre des choses dès lors que sera prise en compte l’origine de chaque pensée, de chaque geste, de chaque processus… origine qui demeure présente, intacte et disponible pour permettre à quiconque d’initier d’autres alternatives que celles qui s’appliquent ici et maintenant.
La Relation réconciliée, un défi humanitaire et créatif
Le titre vise à mettre en scène une double ambiguïté.
Le terme relation, employé dans son sens le plus dynamique, désigne autant ce qui relie que ce qui se relate ; il induit une interaction et un récit qui se créent et qui se façonnent à l’image d’une œuvre accomplie par l’homme, intentionnellement et esthétiquement[2]. En cela, la relation se différencie ouvertement de son principal synonyme : le lien, qui attache.
Quant au mot réconcilié, il met en lumière l’opposition qui existe entre la « civilisation qui civilise »… » et celle où l’on « est civilisé ». La première procède d’une culture du jugement de valeur qui définit ce qu’est une « bonne civilisation », modèle à universaliser. La seconde résulte du désir de vivre ensemble dans le respect de l’intégrité de chacun et dans la volonté de conduire des projets communs.
Le défi de la civilisation est de s’entendre, de se réconcilier en parmanence. S’entendre grâce à des vocabulaires partagés. Pas à des indiscutables, ni à des absolus, ni à des normalités. L’enjeu est de se nourrir de ce qu’on entend et d’imaginer comment on peut l’enrichir et le transformer : c’est le sens même du mot feed-back, il représente une fonction primordiale dans la relation.
S’entendre implique un travail de compréhension mutuelle assidu de l’ordre de l’alimentation quotidienne autant que de la création artistique. On ne s’entend pas une bonne fois pour toutes parce qu’on aurait édifié un lexique ou catégorisé l’identité des interlocuteurs.
Le « barbare[3] » est celui que l’on n’entend pas et dont on dit qu’il ne « veut rien entendre » : chacun est le barbare de celui qu’il ne comprend pas. La barbarie commence par le jugement a priori d’un individu sans avoir expérimenté de relation avec lui. L’idée de Relation réconciliée est sous-tendue par la bienveillance, au-delà de toute morale et de toute complaisance, en deçà de toute solidarité qui aiderait à survivre. Elle s’associe aux messages qui annoncent que le bien-être est une finalité en soi[4] et qui dénoncent l’imposture consistant à faire croire que la nature humaine est héritière de quelque malédiction et mal-être originels[5].
« Donnez-moi un point d’appui et un levier, je soulèverai le monde. »
La promesse d’Archimède tient toujours. En l’occurrence, considérons que le point d’appui est formé par le couple intention et attention : intention de tisser une relation constructive avec l’autre et attention à l’égard des perceptions et des désirs de l’autre par rapport à cette relation.
Le levier proposé procède de cinq principes d’action indissociables, cinq repères significatifs et cardinaux nécessaires à la concrétisation d’une relation humaine de qualité :
-
- Libérer sa créativité.
- Concevoir la relation comme une œuvre au quotidien.
- Expérimenter sans cesse l’étonnement.
- Revenir sur les décisions entérinées et revisiter les alternatives.
- S ’affranchir des vérités édictées et se « sevrer de l’absolu ».
1. Libérer sa créativité.
La créativité est une énergie puissante capable de révéler des talents souvent réduits par les inhibitions : la relation a besoin de cette force pour s’investir authentiquement, émotionnellement, dans un projet commun, pour s’engager dans le dialogue et dans le partage des idées.
La créativité est aussi une aptitude qui permet à l’homme de varier ses points de vue à-propos d’une même chose ; il peut donc lui-même apporter plusieurs idées différentes en réponse à un même problème comme il peut accepter d’autres idées que les siennes. L’attitude créative initie l’échange de façon très ouverte, sans censure ni jugement, elle pousse à explorer le plus grand nombre de possibles afin d’enrichir le consensus avant de conclure. Il ne s’agit pas d’un style de communication et encore moins d’une rhétorique mais de l’expérimentation sans cesse renouvelée de la relation humaine dans ses dimensions constructive et interactive.
2. Concevoir la relation comme une œuvre au quotidien.
Une œuvre humaine, quelle qu’elle soit, se créé chaque jour, humblement et puissamment. La relation est à la base de toute œuvre humaine qui considère que vivre en intelligence avec les autres est primordiale à toute forme de politique, d’économie, de culture.
La relation est un acte quotidien qui consiste à personnaliser toute interaction avec l’autre, à expliciter l’intention spécifique qui la mobilise, à stimuler une attention assez vive pour s’ouvrir à l’autre avec autant d’énergie et de conviction que pour affirmer ses propres enjeux.
Le quotidien désigne une fréquence, un rythme, une opiniâtreté, une permanence… qui, à la différence du « normal » ou de l’« ordinaire », ne se réfère à aucun comparatif, (anormal, exceptionnel…), ni à aucune autorité supérieure, à aucun a priori, à aucun jugement. Au pire, il induit une routine anesthésiante ; au mieux, il inspire une expérience édifiante : celle de la volonté d’accomplir chaque instant « sur mesure ».
Le quotidien invite assidument et intentionnellement à signifier chaque chose et à incarner chaque correspondance qui donne du sens à telle manifestation par rapport à tel concept ou à tel principe. La relation en tant qu’œuvre génère une humanité créatrice de valeurs, d’intelligences et d’émotions renouvelables.
3. Expérimenter sans cesse l’étonnement.
La relation des hommes entre eux a pour vocation de naviguer tous les jours davantage à même l’expérience immédiate, au large des modélisations et des exemplarités, à distance des évidences et des dictats. Elle participe au jour le jour à la réconciliation de la philosophie et de la banalité, considérant qu’il est temps de dérouter la première d’une trajectoire trop souvent guidée par la performance rhétorique et d’autoriser la seconde, méprisée injustement, à se nourrir des désirs de grâce.
La relation est à l’image de l’enfance, familière des initiations primordiales, exposée de plein fouet aux aléas d’une éducation fréquemment improvisée et abusivement instinctive. La relation commence avec l’enfance, et il est urgent de modifier radicalement le regard des « adultes-éducateurs » vis-à-vis de l’« être humain qui naît », de celui qui dès son premier souffle tutoie le quotidien de l’origine et se fabrique lui-même au fil d’étonnements permanents.
On confond trop souvent « pleine écoute » et ignorance, ce qui conduit les adultes à gaver les nouveau-nées de leur propre expérience, à les formater à une rationalité qui discréditera les capacités d’étonnement initiatiques.
Le clivage est déterminant par rapport à la relation, selon le sens attribué à la connaissance : soit elle est source et fruit de l’étonnement (… et d’une attitude civilisée) et chacun a vocation de se découvrir soi-même ; soit elle devient un facteur discriminant (… et barbare) en distinguant « ceux qui savent » de « ceux qui ne savent pas ».
Le respect de soi-même et des autres ne peut s’exercer dans la certitude acquise et immuable ; l’étonnement ouvre à l’humilité (« La vraie connaissance est de connaître l’étendue de son ignorance[6]. ») autant qu’à la reconnaissance des talents de chacun à apprendre par soi-même avec les autres (Socrate et la maïeutique) pour ne citer que ces deux grands penseurs bien célèbres mais assez peu présents dans la culture dominante de la relation plutôt fondée sur les rapports de force.
4. Revenir sur les décisions entérinées et revisiter les alternatives.
Tout ce qui nous arrive a du sens et la qualité de la relation est inhérente à la responsabilité de chacun vis-à-vis de son propre destin. Toute décision résulte d’un choix issu d’une alternative où la modalité « A » a été préférée à la « B », à la « C », à la « D »… Chaque choix opéré à l’insu d’un individu, avant et depuis sa naissance peut être « revisité » par ce dernier. C’est un acte salutaire que de s’affranchir des scénarios héréditaires et des messages parentaux, non pour les dénier ou les renier mais pour les réinterroger. Pour investiguer aussi les alternatives et rouvrir les voies abandonnées (et y déceler souvent le sens des non-dits et des interdits).
Même si son propre choix reprend l’option retenue initialement, il est sain de se demander comment l’appliquer autrement : ce mouvement continu garantit l’équité relationnelle, il évite de laisser s’instaurer une caste d’ « auteurs décisionnaires » et une autre d’« acteurs applicateurs », chacun doit exercer ces deux fonctions et engager des relations matures et… civilisées ; elles le seront d’autant mieux qu’elles se libèreront des injonctions paradoxales qui polluent les consciences.
Tout scénario de vie, toute croyance, toute affirmation, tout mot utilisé… recèlent la clé de l’acte décisionnaire effectué antérieurement, il y a peut-être très longtemps, et qui conditionne la posture d’aujourd’hui. Dans l’idéal, rien de ce qui nous arrive ne devrait échapper à notre questionnement : qui a voulu cela ? Quelle intention l’a motivé ? De quelles manières a-t-il /ont-ils accompagné la mise en œuvre et assumé les conséquences ?
Peu importe le délai des réponses, voire même la validité de leur contenu : ce qui compte c’est de n’admettre rien qui soit « comme ça… », pas plus que d’accepter bénignement de « ne pas y avoir pensé », ce qui compte c’est de se réapproprier le récit de notre propre existence. L’enjeu est individuel, certes, il est collectif également. La question concerne ce qui organise une communauté, une cité, un pays. Les lois, les règles, les pratiques, les rites, les us et coutumes… procèdent-t-ils d’une signification reconnue par tous ? Permettent-ils à chacun de se positionner librement ? Facilitent-ils la réactualisation des consensus ? Donnent-ils envie de vivre ensemble ?
La recrudescence de certains débats qui déroutent l’opinion (identité, « théorie du genre », GPA…) est probablement liée à la méconnaissance (ou à l’évidence, ce qui revient au même…) de l’origine des règles qui régissent la société par le plus grand nombre ; à cela s’ajoute la propension à « sanctuariser » les institutions, ce qui érige un obstacle supplémentaire à la redécouverte de l’origine des pratiques et à la créativité nécessaire pour en réinventer les modalités. Il s’agit pour cela de considérer l’origine au présent (et non comme un fait chronologiquement passé) et d’éviter tout projet de « table rase » et toute initiative eschatologique[7] et rédemptrice.
L’approche n’est pas inédite : elle constitue le fondement des sagesses asiatiques, en particulier chinoises[8]. Elle ouvre d’immenses champs très peu explorés, trop peu cultivés en tous cas, ceux où germe l’aptitude de chacun à innover chaque relation comme si celle-ci était première et singulière. Elle montre surtout combien il serait limitant et peu convaincant de se contenter d’un apprentissage élémentaire pour faire évoluer les attitudes et les comportements, combien il est essentiel de revisiter les récits originels présents et vivants qui impactent notre quotidien.
5. S’affranchir des vérités édictées et se « sevrer de l’absolu »
Le besoin de recourir à une autorité de « quelque chose » ou de « quelqu’un » qui nous dépasserait conditionne intrinsèquement la relation humaine. « Que deviendra l’homme sans Dieu et sans immortalité ? Tout est permis par conséquent, tout est licite ? », réplique signée Dostoïevski, citée en exergue, qui résume à elle seule la question de la maturité : pour être forte et respectueuse, la relation doit s’affranchir de toute « tierce conscience ».
En soi, tout principe totalitaire, exclusif et par là-même dominateur et barbare s’appuie sur l’absolu, sur la vérité unique, sur la sacralisation indiscutable… La dimension philosophique, voire métaphysique, de la relation se concrétise par le « sevrage de l’absolu » et, conséquemment, par l’essor de la relativité…
L’enjeu en vaut la chandelle, car y parvenir c’est se permettre de vivre sereinement, en toute autonomie mentale, c’est se familiariser avec le provisoire et l’incertitude, sans confier la responsabilité de notre destinée à quelque figure parentale supérieure.
Certes, cette réflexion ne peut faire l’impasse sur la question de Dieu. En l’occurrence, défendre son existence ou la nier serait hors sujet. Ce qui importe, c’est de discerner en quoi la prégnance du divin dans les imaginaires influe sur les relations humaines… Dieu représente précisément l’absolu[9], l’ « achevé », le « parfait ». (par-/per- traduit l’idée d’une action menée « jusqu’au bout »), il symbolise l’idée qu’il n’y a plus rien à faire sinon se résigner à l’immuabilité… ou prendre le risque (« surhumain ? ») d’affronter l’incertitude illimitée. Un tel imaginaire est en tout point semblable à celui qui jadis se représentait la terre comme un disque plat bordé par l’abime. Et si discréditer caustiquement cette croyance serait anachronique, imaginer qu’une croyance actuelle est intangible relève de l’archaïsme. La problématique de la terre ronde (versus plate) est très similaire à l’avènement majeur d’un nouveau paradigme : le « fini » (versus l’« infini »)… la « relativité » (versus l’ « absolu ») que nous sommes en train de vivre.
Car au-delà des aspects conceptuels, il convient de se rendre compte à quel point le crédit accordé à une puissance supérieure, « bonne » ou « mauvaise », implique de fait le concept d’infériorité : comment une telle représentation du monde pourrait-elle générer autre chose que le principe vital de domination ?
Il s’agit alors de remonter à la racine d’un malentendu héréditaire qui confond la « chose sacrée », respectable tant qu’elle est respectueuse elle-même, et l’« ordre sacré pyramidal », autrement dit la « hiérarchie[10] ». La croyance qu’un ordre supérieur et qu’un ordre inférieur sont inhérents à la société des hommes ne relève d’aucun fondement irrévocable. Elle justifie surtout toute forme d’impunité et d’abus de pouvoir, assortis de l’usage de la violence et de la répression au titre de la « Raison d’état[11] ».
La Relation réconciliée ne peut composer avec l’existence de quelque « être supérieur » dont le dogme influence nuisiblement la culture relationnelle, oriente les choix politiques et sociaux, conditionne l’éducation, calibre la latitude de l’imaginaire, soutient les pouvoirs et entretient une division flagrante pour mieux régner.
« Se sevrer de l’absolu » est une proposition qui invite à faire fructifier ses propres ressources, à rompre avec l’indignité manifestée face à l’inconnu et à l’incertitude… et à découvrir les aptitudes humaines à créer plutôt qu’à mystifier.
Chacun de ces points cardinaux se retrouve en transversal dans l’ensemble de l’ouvrage (voir le sommaire complet ci-après). Ils annoncent que des alternatives inexplorées existent, prêtes à voir le jour, pourvu qu’on libère ce ressort marginalisé jusqu’alors : la créativité, et qu’on se dégage de la crainte d’exister par soi-même. Ils dénoncent la croyance qui stipule que la culpabilité serait naturelle tout comme la violence et le malheur qui en découleraient irréversiblement.
« La philosophie est la science qui nous apprend à vivre[][12]. »
Michel de Montaigne, à qui l’on prête d’avoir créée le genre de l’essai, invite chacun à pratiquer la maïeutique à partir de sa propre expérience et d’explorer les représentations en jeu. C’est ce travail de correspondance entre le concret des situations et l’abstrait des significations qui est développé dans ce projet. Bien se connaître soi-même permet d’avancer des idées que l’on peut partager avec les autres, sans étayer nécessairement sa légitimité auprès d’auteurs référents reconnus mais sans non plus se priver de les citer quand ils traduisent limpidement son propre point de vue.
La relation réconciliée s’appuie abondamment autant sur les préceptes traditionnels, spirituels et philosophiques, que sur les découvertes contemporaines en matière de communication, de psychologie ou de biologie ; il contribue à ouvrir une fenêtre peu explorée jusqu’alors qui donne à voir sur le rôle de la créativité[13] dans les actes quotidiens, créativité qu’on a réservée longtemps aux domaines de la création artistique et de l’invention technique ou scientifique.
L’exigence quotidienne et créative, tant de la relation elle-même que de l’écriture (qui est une forme de relation), conçoit ses repères de multiples façons. L’un d’eux, privilégié dans ce travail, est l’étymologie des termes, car l’origine de chacun est aussi décisive que le scénario de tout être vivant, pour comprendre et analyser, et pour puiser les sources d’énergie et d’inspiration nécessaires à l’accomplissement de l’ « œuvre relationnelle ».
Pour autant, l’étymologie n’apporte aucune vérité indiscutable, elle se contente de révéler que de nombreuses expressions éculées recèlent une racine éclairante, souvent inattendue tant l’évolution de certains mots en ont édulcoré la signification fondatrice[14]. L’outil étymologique est d’autant plus relatif et suggestif qu’il évoquerait d’autres pistes sémantiques s’il était pratiqué dans une autre langue d’expression que le français[15].
Conformément à l’esprit de cette démarche, il est peu fait usage de la rhétorique dont la rigueur rationnelle et le souci de démonstration cannibalisent trop souvent la pensée et l’objet même de la sagesse : la vie quotidienne de tout un chacun. Il s’agit d’une approche empirique ni érudite ni naïve, principalement dédiée à la pratique journalière du questionnement et du mieux vivre ensemble.
Il y est régulièrement fait référence à des penseurs traditionnels et contemporains autant qu’à des chercheurs et des praticiens ; les réflexions métaphysiques sont mises en perspective avec des événements les plus « insignifiants », les énoncés conceptuels de nature scientifique ou clinique (l’ethnologie, la sociologie, la psychologie, la biologie ou l’astrophysique) fréquentent les observations les plus familières, voire les plus triviales.
Il ne s’agit ni d’un traité ni d’une thèse, les œuvres des auteurs cités[16] participent à une culture générale de base, davantage destinée à stimuler la pensée et la créativité qu’à légitimer un propos ou constituer un corpus académique.
Enfin, l’expérimentation est maîtresse du jeu : chaque idée, chaque évocation, chaque phrase est soumise à l’épreuve de la cohérence entre le concret et le concept, entre l’idée et la source, entre l’intellect et l’intelligence, entre les actes et le récit fondateur…
[1] « Nouvelle Communication », Analyse Transactionnelle, PNL, Systémique, Sémantique générale…
[2] Esthétique : aisthanesthai (grec) = sentir – Aien (indoeuropéen) = entendre, percevoir.
[3] Barbare : barbara (sanskrit) = qui bredouille [onomatopée] Le barbare est celui qui s’exprime de façon incompréhensible.
[4] Épicure a largement contribué au développement de cette idée.
[5] La tradition monothéiste a exercé un pouvoir conséquent à partir de cette représentation.
[6] Confucius.
[7] Eschatologie : eschatos (grec) = qui se trouve à l’extrémité, dernier – Lógos (grec) = parole, étude.
Le terme provient de la théologie et de la philosophie religieuse pour désigner le discours et l’étude à propos de la fin dernière de l’homme et du monde.
[8] Par exemple, les graphies chinoises ne désignent pas des mots qui correspondent à des choses, mais des fonctions qui créent des liens entre une situation et le sens immédiat ou prospectif de cette situation. Voir « Les deux raisons de la pensée chinoise. Divination et idéographie » – Léon Vandermeersch. Gallimard – Cité dans « Philosophie Magazine », N°30 du 30/05/2013.
[9] Absolu : ab (latin) = séparé de… – Solvere (latin) = résoudre, solution – Absolvere (latin) = détacher de, se débarrasser de, d’où achevé, terminé et au figuré : détacher du péché.
[10] Hiérarchie : hieros (grec) = sacré – Arkhê (grec) = pouvoir, commandement. Archos (grec) = commencement, ce qui est premier…
[11] Les états sont fondés et dirigés par le pouvoir religieux. La séparation du politique et du religieux est une révolution marquée par l’avènement de la laïcité, ancienne d’à peine quatre générations.
[12] Essais, I
[13] Créativité, le mot apparaît très récemment (années 1970) dans les dictionnaires.
[14] Exemple parmi des centaines : étonné signifie foudroyé à l’origine…
[15] La quasi-totalité des références étymologiques est puisée dans le Dictionnaire Historique de la Langue Française publié sous la direction d’Alain Rey, Dictionnaire le Robert, Paris, 1992.
[16] Les sources sont multiples, la plupart du temps fournies par des rencontres, par la lecture de livres et de revues, par l’écoute d’émissions (radio et tv) et des conférences et par la pratique fréquente de la conversation. Wikipédia fait partie de ces sources, même s’il est souvent utilisé comme palliatif aux lacunes de la mémoire et intervient en rappel de données connues mais oubliées.
Essais méthodologiques
Ces trois ouvrages développent les pratiques, les méthodes et les enjeux stratégiques de l’Innovation Participative. Initiée dans les années 1920 sous forme de boite à idées et de groupe de résolution de problèmes principalement dans les secteurs industriels, l’Innovation Participative est devenue dans les
années 1990, une véritable démarche managériale à part entière touchant l’ensemble des domaines d’activité. Intégrer la participation créative de tous les collaborateurs devient un levier de motivation et de création de valeur économique.
Manager par les défis, 2007, se focalise sur un volet de l’Innovation Participative qui se développe très vite : l’innovation de rupture qui est provoquée selon les axes stratégiques de l’entreprise. Comme le premier ouvrage, il met en valeur des témoignages d’entreprise, des méthodologies réactualisées et des clés stratégiques.
François-Marie Pons et Marjolaine de Ramecourt
Éditions d’Organisation (Eyrolles)
S’Organiser pour innover, 2007 est un état de l’art présenté sous forme d’étude qualitative d’une trentaine d’entreprises où la démarche d’Innovation Participative a été mise en place depuis plusieurs années. Les pratiques spécifiques, le dispositif, les résultats, la perception des collaborateurs sont décrits précisément.
François-Marie Pons
Management Stratégique, Études les Echos
L’innovation à tous étages, 2001, décrit la démarche dans son ensemble, le témoignage des pionniers dans l’entreprise, la description pratique des outils (créativité, communication, management), l’appropriation stratégique des dirigeants.
Cet ouvrage a donné lieu à le lancement de l’association professionnelle de l’innovation participative, Innov’Acteurs dont François-Marie Pons est à l’initiative et cofondateur.
Les trophées de l’innovation participative sont décernée annuellement, suite à un audit qualitatif des candidats, réalisé à partir d’un Référentiel de l’Innovation participative mis au point par les membres de l’association.
François-Marie Pons et Marjolaine de Ramecourt
Éditions d’Organisation (Eyrolles)
Manager par les défis
François-Marie Pons et Marjolaine de Ramecourt, dessins Gabs
Éditions d’Organisation (Eyrolles)
1999
Ces mots qui en disent long !!!
Les mots en disent long sur les comportements. Le sens contenu dans leurs véritables racines démasque des stratégies, conscientes ou non, et fournit de précieux atouts. Quelqu’un qui vous paie, par exemple, cherche à obtenir la paix. Le saviez-vous ? Le monde des affaires et des entreprises s’est ainsi constitué une panoplie de mots d’ordre qui invitent chacun à aller tout droit dans un sens convenu.
Il est convenu, par exemple, que « cohésion », « projet », « service plus », « énergie » ou « réseau » ouvrent sur l’avenir et la croissance ; que « organisation », « technicité » ou « formation » incitent à la performance et à la rigueur ; tandis que « problème » ou « crise » annoncent le pire.
En réalité, ces mots camouflent des significations très inattendues qui dévoilent une face qu’on ne saurait voir !
Faites un test auprès de vos proches.
Qui apportera la « vraie » réponse à ces quelques questions :
– à quel penchant des clients doit on le formidable succès du « service plus » ?
– quelle menace pèse sur une bonne cohésion d’équipe ?
– pourquoi les individus de sexe masculin sont-ils aussi avides de pouvoir ?
– en quoi une organisation efficace est-elle naturellement sujette aux changements les plus irrationnels ?
Les surprises ne manquent pas !
lire la suite...
Vous irez de découvertes en découvertes, vous mettrez au défi vos amis, vos collègues, vos patrons ! Et vous stimulerez votre créativité !
Notre civilisation des changements a étouffé ses racines, a dilué ses valeurs.
Les mots, une fois ouverts comme des boîtes de Pandore, livrent crûment leur secret de famille et la vérité de leur tout premier cri. Car à force d’être proclamés dans tous les sens et transformés en totems, ils en ont perdu leur sens (et leur latin !) Et nous font oublier, qu’au cœur d’eux-mêmes, ils véhiculent une culture qui nous colle à la peau.
L’étymologie – du grec « etumon » : vrai – est la « recherche du vrai sens » des mots, chacun recelant des significations bien différentes de celles qu’on s’efforce de vouloir leur faire dire. La connaissance de leur origine authentique représente une aide précieuse. Parce que nous comprenons mieux les situations qu’ils évoquent. Parce que nous avons davantage de recul pour décider de la meilleure option à suivre.
Le face à face des mots d’aujourd’hui avec leurs ancêtres les plus lointains raconte toute une histoire, aussi riche en images et en enseignements qu’un conte initiatique !
Les auteurs
Note : La plupart des informations ont été puisées dans le Dictionnaire de l’Histoire de la Langue française d’Alain REY.(Robert)
La Communication interne en entreprise qui a débuté sous forme d’un journal papier consacré aux messages de la direction, est devenue dans les années 1990 un adjuvant au management, jusqu’à devenir dans les années 2010 la communication managériale. C’est de cette mutation dont témoigne cet ouvrage pionnier en ce domaine en proposant des apports des pratiques, des démarches, des outils issus de la créativité, de la psychologie appliquée et de la nouvelle communication de Palo Alto. La contribution participative de l’ensemble des collaborateurs, au niveau des idées et des opinions, des réflexions et des partages d’expérience devient l’enjeu majeur des organisations humaines, quel qu’en soit la taille, le domaine d’activité ou l’ancienneté. La Communication Pratique fait partie des ouvrages initiatiques en la matière.
La Communication Pratique au service des entreprises
François-Marie Pons et Hubert Jaoui
ESF éditeur
1993